La vidéo de la femme poussée sur les rails du métro bruxellois a fait couler beaucoup d’encre. Les points de vue divergent qu’il s’agisse du respect de la loi et des victimes, de l’éthique, de la déontologie, et d’encore bien d’autres choses. L’usage de certaines images par les médias a toujours été au centre de débats difficiles, mais indispensables. Les motivations pour lesquelles les rédactions décident de diffuser des images qui posent des problèmes déontologiques sont variées et ont évidemment évolué notamment avec la toute-puissance des réseaux sociaux et la condition de production des images. Les contextes ne sont pas les mêmes, mais pour indiquer que les questions de fond sont posées depuis belle lurette, je me permets de reproduire ici le premier chapitre d’un livre que j’ai publié en 1997… et qui concerne un événement de 1985. Rien n’est comparable en termes de situations — et le texte est connoté par l’époque — mais une constance déjà imprimait sa marque sur les choix éditoriaux : la concurrence et la loi du marché.
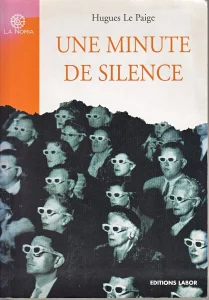
Le livre s’intitulait « Une minute de silence – Crise de l’information, crise de la télévision, crise du service public » ( Editions Labor, 1997). Il commençait comme ceci :
CHAPITRE 1
L’IMAGE ET « LES AUTRES »
L’image est insupportable, impudique, indécente.
L’image d’un enfant qui va mourir.
L’image d’un monde impuissant.
Faut-il la montrer ? Peut-on, doit-on la « retenir » ?
Image signifiante ou image complaisante ? Sens ou spectacle morbide ? Le débat est difficile.
La décision est tombée glaçante, sans contestation possible, avec l’accord de presque tous : oui nous allons passer cette image dans la prochaine édition du Journal Télévisé, parce que, de toute façon, « les autres » vont le faire…
Tout est là, dans ces deux mots : « les autres ».
C’était plus qu’une alarme. Presque, déjà, une confirmation car il y avait déjà eu d’autres alertes, des signes avant-coureurs.
On pressentait un divorce entre l’information télévisée et une certaine idée du service public. L’éloignement ne se transformerait pas immédiatement en rupture. Il y aurait encore des soubresauts, des allers et venues, des tentatives de réconciliation. Les chemins de la séparation seraient d’abord détournés, parfois même tortueux, mais ils étaient tracés.
C’était le 17 novembre 1985, un dimanche. Il n’ y avait pas beaucoup de monde à la rédaction du « JT » (Journal télévisé) de la RTBF : une équipe normalement réduite pour un week-end sans « actualité chaude ». Ceux qui étaient là représentaient bien le « corps journalistique » de l’époque dans ses diversités et ses ressemblances, avec ses qualités et ses défauts.
L’ensemble des présents est regroupé autour des moniteurs qui diffusent , à heures fixes, les « EVN », cette bourse d’échange organisée par l’ UER -l’Union Européenne de Radio-Télévision- mère nourricière en images uniformes la plupart des chaînes du monde occidental.
Facteur de standardisation de l’information télévisée, cette forme d’échange est un instrument à la fois indispensable et pervers surtout pour les télévisions « pauvres » qui n’ont pas les moyens d’envoyer des équipes de reportages aux quatre coins du monde. Inutile de préciser que la RTBF appartient à cette dernière catégorie…
Au même moment, sous toutes les latitudes, des milliers de journalistes font à peu près les mêmes plaisanteries plus ou moins cyniques devant le défilement rituels de manifestations, de déclarations ou de catastrophes, sans compter les images anecdotiques qui feront une bonne « fin » de journal à moins qu’elles n’en fassent la « une »… Simple question de hiérarchie de l’information.
Pour ce qui concerne les catastrophes, celles qui auront l’honneur de la prochaine édition du JT, sont sélectionnées selon la loi bien connue et enseignée dans toutes les écoles de journalisme du « mort kilométrique ». L’importance accordée à la mort – aux morts- varie en fonction de la distance géographique ou/et culturelle qui nous sépare de la tragédie.
Cinq cents morts dans une collision ferroviaire dans les faubourgs de Djakarta ne « valent » évidemment pas cinq victimes d’un déraillement à Namur. L’appartenance des victimes à la civilisation occidentale est cependant un puissant correctif à la notion d’éloignement du drame. Toutes les télés du monde réagissent de la même manière. La loi est universelle.
Et pourtant ce dimanche matin les regards blasés des rédacteurs distraits qui voient défiler la mort sur écran à longueur de journées se sont arrêtés sur une image. Silence dans la rédaction. Les conversations s’interrompent quand elle apparaît à l’image, affaiblie, les yeux presque clos qui s’ouvrent grand pour convaincre et se convaincre qu’elle va continuer à combattre la mort.
Un torrent de boue, provoqué par l’éruption du volcan Nevado del Ruiz, a entraîné la disparition de vingt-cinq mille Colombiens dans la région d’Armero. Le sort d’ Omayara Sanchez, la « petite fille d’Armero » ,prisonnière de la boue, va tenir en haleine des milliards de téléspectateurs qui assistent à son inexorable agonie. Chaque édition de « JT » va fournir son bulletin de mort en sursis et en images. Impossible de dégager la petite fille qui semble adresser, seule au monde, son message de désespoir absolu. En face d’elle il y a pourtant des dizaines d’yeux accourus du monde entier. Un demi-cercle dense de caméras et de micros en rangs serrés. Ce contre-champs qui ne sera pas montré au téléspectateur résume brutalement un rapport entre deux mondes. Dans l’information télévisée, les contre-champs ne sont jamais montrés. Sans doute parce qu’ils sont trop révélateurs de la position de celui qui médiatise. Parce qu’ils pourraient casser l’apparence lisse et univoque du message. Ou simplement parce qu’ils dévoilent souvent la face cachée du monde et de l’information.
Omayara résistera encore quelques heures avant de mourir d’épuisement. Rien n’oblige, bien sûr, les télévisions à diffuser ces images qui leur sont proposées.
Le JT de la RTBF rendait évidement compte du drame que vivaient les survivants d’Armero. Fallait-il diffuser les images d’Omayara qui n’apportaient pas de véritables informations mais qui risquaient de transformer l’information en un feuilleton teinté de voyeurisme ?
Le débat s’était engagé au sein de la rédaction entre journalistes d’expériences équivalentes et sans qu’aucun argument d’autorité ne soit avancé par ceux qui avaient la responsabilité du journal. Un véritable discussion « inter pares » sans autre enjeu que la définition de ce qui devait être notre rôle celui d’une télévision de service public – en la circonstance.
Très vite les clivages apparaissent. Il y a ceux qui refusent d’utiliser systématiquement ce qu’ils considèrent comme une dérive voyeuriste, comme une déviation perverse de l’information en images et , en fin de compte, comme un irrespect de l’être humain. L’argumentation repose aussi sur le fait que l’image dramatique n’apporte pas d’autres éléments d’information sur le sort d’Omayara, ni sur la situation plus globale des dizaines de milliers de victimes de la catastrophe.
Les autres – plus nombreux- justifient de différentes manières la nécessité de diffuser ces images. Certains estimant qu’il n’ y a pas à censurer une image qui existe et intéresse et doit forcément émouvoir ceux qui nous regardent. D’autres encore avancent une argumentation de type « humanitaro-médiatique » qui sera plus tard largement utilisée par Bernard Kouchner et ses émules: l’émotion provoquée par le sort et les images d’Omayara permettent de mobiliser les consciences et les dons de l’opinion en faveur des victimes de la catastrophes. Pendant une longue heure arguments et contre-arguments s’échangent dans une apparente volonté commune de trouver une attitude qui corresponde le mieux à la mission d’information telle que nous semblons communément la concevoir.
Les opinions évoluent, se modifient parfois dans le courant du débat : partisans et adversaires de la diffusion de ces images semblent tout à tour l’emporter. Mais la décision ne s’impose pas d’elle-même. L’hésitation demeure. Jusqu’au moment où l’argument décisif sera lancé par l’un des participants : « de toute façon même si nous ne les passons pas, « eux » les diffuseront, alors… ». « Eux », « ils », les « autres », les concurrents n’hésiteront pas. Quelles que soient leurs propres réserves éventuelles, ils montreront l’agonie d’Omayara car ils « savent » que les téléspectateurs « attendent » ces images. En quelques minutes le débat a basculé : la majorité -l’immense majorité des journalistes présents ce dimanche de novembre 1985 a jugé l’argument décisif, l’emportant sur tous les autres, rendant caduque toute discussion. Nous sommes restés à deux ou trois, campant vainement sur nos positions de principe et de refus.
Sans que les uns et les autres en aient eu véritablement conscience, il s’est passé ce jour-là quelques chose d’essentiel pour l’évolution de l’information télévisée à la RTBF. L’argument de la concurrence -de la surenchère ou du suivisme, c’est selon- l’avait emporté sur tous les autres . L’éthique, la déontologie, les principes moraux et professionnels avaient été balayés en quelques secondes par l’impératif absolu, l’exigence supposée de la concurrence. C’était la première fois que les choses étaient dites aussi crûment. La situation n’était évidemment pas isolée ni exceptionnelle. Quelques années plus tard le sociologue Pierre Bourdieu la résumera dans ces termes : « …Le collectif dont les messages télévisés sont le produit ne se réduit pas au groupe constitué par l’ensemble d’une rédaction; il englobe l’ensemble des journalistes. µ
On pose toujours la question : « mais qui est le sujet d’un discours ? ». On n’est jamais sûr d’être le sujet de ce qu’on dit… Nous disons beaucoup moins de choses originales que nous ne le croyons. Mais c’est particulièrement vrai dans des univers où les contraintes collectives sont très fortes et en particulier les contraintes de la concurrence, dans la mesure où chacun est amené à faire des choses qu’il ne ferait pas si les autres n’existaient pas (…) ».[i]
Une époque prenait fin. Un nouveau chapitre de l’information télévisée s’ouvrait. Il n’y avait eu besoin d’aucune pression d’aucune sorte pour imposer cette attitude. La majorité des journalistes s’étaient rendus de bonne foi et de plein gré à l’argumentation de la concurrence. Personne n’avait le sentiment de trahir une certaine conception de l’information qui avait jusque-là dominé le service public. Simplement ils évoluaient avec le temps. Ils s’adaptaient. Certains pensaient sans doute que c’était la condition même du sauvetage de la RTBF sérieusement menacée par les gains d’audience de la télévision privée. Il y avait certainement déjà eu d’autres cas de figures assez proches, l’argumentation était dans l’air du temps.
On aurait pu illustrer l’évolution du service public par un autre exemple. Mais celui-ci reste extraordinairement emblématique car il est le fruit d’une discussion spontanée entre journalistes ( plus ou moins ) égaux et sans intervention extérieure ou hiérarchique. Simplement la conception médiatique des années 80 triomphait. Les journalistes avaient intégré cette manière de réagir à la concurrence par l’abandon de la différence.
Il y aura par la suite d’autres dérives sans doute bien plus inquiétantes et scandaleuses – nous y reviendrons largement- mais, ce jour-là précisément, j’ai eu le sentiment que l’ information télévisée telle qu’elle s’était pratiquée jusque-là dans le service public changeait de nature.
[i]. Pierre BOURDIEU, Pierre, « Sur la Télévision suivi de L’emprise du journalisme, Raison d’Agir, Liber éditions, Paris, 1996, p.23

il y a les images publiées « parce que de toutes façons les autres vont les publier » (et, plus ou moins sous-entendu : et le public ira les voir) et aussi les images publiées qui déclenchent des procès. ces dernières posent la question de la manipulation de l’opinion par l’image frappante, émotionnellement mobilisatrice (tant dans le sens du fanatisme pour que du rejet absolu contre). L’intention d’influencer l’opinion, c’est-à-dire l’effet recherché, éclaire l’éthique différemment. ce n’est plus l’image elle-même qui est éthique ou pas (elle n’est qu’une partie du Réel) mais son utilisation qui est problématique…
Cher Hugues, merci de nous permettre de nous positionner sur un des sujets les plus importants de notre quotidien qu’est la nécessité ou l’utilité d’être informé d’un évènement quel qu’il soit. Je me pose à chaque fois la question » à qui profite l’info » ? Personnellement je pense que toute info doit servir prioritairement à celui qui la reçoit et non à celui qui la donne. C’est pour moi la principale interrogation qui doit guider la divulgation d’une nouvelle au public. A partir de ce constat il y a la méthode. C’est à partir de ce moment que le risque existe de satisfaire le spectateur dans ce qu’il a de plus abject, le plaisir de contempler le malheur d’autrui. C’est le succès de Paris Match » le poids des mots, le choc des photos ». Si l’on se contente du choc des photos ou des gros titres on capte les sens premiers du spectateur ou lecteur à savoir son goût inné pour le voyeurisme vulgaire. Ce qui m’a choqué humainement dans la terrible info du drame de la petite Omayara c’est son côté feuilleton. Pas ou trop peu de rédactionnel sur ce tragique événement mais principalement des images chocs montrant une agonie. J’en veux aux multiples caméramans et ou photographes d’être restés scotché sur cet enfant. Cette attitude m’amène à raconter cet épisode horrible d’un cameraman scandinave demandant d’ interrompre pendant quelques minutes l’exécution d’un condamné face au peloton d’exécution; le temps pour lui de recharger le magasin de sa caméra. Ecouter Soeur Emmanuelle ou Nelson Mandela racontant avec des mots simples leur parcours respectifs émeut et nous instruit beaucoup mieux et suffisamment. Enfin, pour moi, l’excuse de proclamer que d’autres vont dévoiler l’info est impardonnable. C’est à ce moment que le droit d’être différent devrait nous motiver. C’est sans doute là que réside la » faute » du politique. Pour qu’un service public existe il faut lui permettre d’exister et donc de lui donner les mêmes moyens que ceux dont profite la concurrence privée.
Cher Hugues,
Tu nous laisses en suspens(e) quant à ta conclusion.
Que l’argument « les autres » l’ait emporté est un mal. Tu le laisses entendre et je suis d’accord.
Reste une question : ceux qui s’y sont rangés avaient-ils pour autant tort ?
Principe de réalité contre réalité des principes…
Merci Cher Tom, dans les 290 pages qui suivent ( ce n’est que le premier chapitre d’un livre), je tente aussi de répondre à cette question.
« Car ils « savent » que les téléspectateurs « attendent » ces images »… est la phrase véritablement choquante dans votre chronique. Qui n’en est pas moins pertinente. Elle formule clairement que « le journaliste » (pour faire court) croit savoir ce qui est bon pour le spectateur, ce qui va « marcher », ce qu’il doit voir, lire ou entendre. Pourtant, se/ce disant, il insulte son auditoire. Il indique que nous n’avons aucune intelligence, aucun sens critique, aucune émotion maitrisée, juste besoin de sensations fortes. Bref, il nous prend pour des abrutis. Dans toutes mes expériences de médias, en interne ou en externe, lors de mes conseils en « com » ou dans le cadre de l’enseignement, j’ai toujours dit « ne prenez pas les personnes à qui vous vous adressez pour des imbéciles ». Du vécu: j’appelle il y a quelques années feu Michel Konen. Je lui explique que ma fille mineure a été assassinée par son compagnon, qui a été dessaisi et devrait passer en juridiction pour adultes, c’est à dire aux Assises. Simultanément, le gouvernement opte en justice pour la réforme « Pot pourri 2 », qui organise le démantèlement presque total de la Cour d’Assises. Le meurtrier de ma fille sera donc déféré devant une Cour Correctionnelle. Je lui dit « le meurtre de ma fille peut être pour vous considéré comme un fait divers, mais le démantèlement de la Cour d’Assises? Il m’a froidement répondu « et vous croyez que ça fait une info, ça? ». Quelques semaines après, suite à un recours à l’Europe, la Belgique a dû renoncer à la destruction de sa Cour d’Assises. Pas un mot. Voilà comment on trie l’information.
Les guillemets autour de « savent » et « attendent » sont évidemment fondamentaux. Je reviens longuement sut cette question dans le livre et pour la résumer je cite cette phrase du premier directeur de la BBC ( 1927), Lord Reith ( qui ne parlait alors que de la radio) : » Celui qui se flatte de donner au public ce que souhaite ce dernier, ne fait, le plus souvent, que créer une demande pour la médiocrité afin de la mieux satisfaire ensuite. ».
PS Je comprends parfaitement ce qu’ a du être votre sentiment face à la réponse de feu le rédacteur en chef.
Splendide et inquiétant réflexion, merci, cher Hugues. Est-ce un proverbe chinois, ou recensé par Erasme, « piscis primum a capite faetet »?le poisson pourrit par la tête, il s’agit en effet de la minutieuse description de la perversion d’une élite. Ta pensée rejoint celle de Michael Sandel, le tout au marché n’affronte pas seulement certaines valeurs au profit d’autres (le creusement des inégalités au lieu de leur réduction) mais il s’insère dans l’espace mental des gens pour corrompre les justifications morales de leur conduite.
En outre, ce qui est remarquable dans ta contribution, c’est à la fois l’analyse d’un milieu professionnel, de ses contraintes relatives à la concurrence des marchés, les amonts et avals politiques et dans ton commentaire, le questionnement suivi de la fermeté d’engagements éthiques.
Merci, et bon chemin.
Bonjour Hugues,
Je partage en tous points ta dénonciation de la dérive amorcée en 1985 par la diffusion des images insoutenables de la mort lente de cette jeune Colombienne. Depuis lors, cette pratique du voyeurisme télévisuel a atteint de larges pans de l’information diffusée par la RTBF… au nom de la concurrence (qui fait souvent encore pire). Elle fait des ravages dans ces JT de 19h30 qui se veulent tout prix « proches du quotidien des spectateurs », au point de devenir, pour la majorité des informations, un journal de faits divers et de petites scènes de la vie quotidienne.
L’un des exemples qui nous a le plus choqués est le traitement qui est fait de la pauvreté dans ce journal télévisé qui, par ses images, se plait à se faire le reflet de la bonne petite classe moyenne, et très peu des milieux populaires, sauf pour en donner une vision misérabiliste. Le sommet a été atteint lors d’un JT de 2020, si mes souvenirs sont bons, qui avait été largement consacré, peu avant Noël, à l’entreprise philanthropique Télévie, dégoulinante de bons sentiments. On y montrait d’abord une famille « Quart Monde » dans son jus, avec des parents désemparés reconnaissant ne plus être en mesure de s’occuper de leurs enfants et leurs deux gamins de 6 ou 7 ans. Ceux-ci sont accueillis par une famille « comme il faut », bien « généreuse » et visiblement contente de montrer tout le bien qu’elle fait en partageant son confort. On montre en gros plans les deux gamins tous gênés et honteux dans leur nouvelle famille et les deux enfants de la famille d’accueil qui expliquent qu’ils ont même dû leur apprendre à manger. Humiliation publique! Cela relève de ce que j’appelle la charité pornographique… Aucun respect pour la vie privée et la dignité. Mais peu importe, pourvu que cela fasse marcher le Charity Business.
Je fais le constat que cette dérive voyeuriste s’est infiltrée jusque dans les plus petits recoins de l’information quotidienne et est devenue parfaitement banale et normale dans le « paysage audiovisuel ».
Alors que l’émotion, la véritable, celle qui éveille l’intelligence et la critique, amène le spectateur à s’interroger sur les causes des situations de pauvreté évoquées à l’écran, et l’appelle à envisager de remettre en cause le système profondément inégalitaire d’où elles tirent leur origine, requiert un traitement sobre, avec un minimum d’images, une relation des faits sans pathos, empreinte de respect de l’intimité et de la dignité de ceux qui, souvent à leur corps défendant, font le sujet du reportage. Et qui souvent, dans la réalité, font preuve d’une énergie, d’une intelligence et d’une force pour lutter et sortir de la précarité dans laquelle on les a cantonnés.
Autre exemple de ce voyeurisme, le film « ni juge ni soumise » consacré par l’émission Strip Tease dans lequel la juge Anne Gruwez se met en vedette, au mépris le plus total du secret de l’instruction et du secret professionnel, occultant complètement, par son ton « sympa », « copain-copain », son tutoiement avec ceux qu’elle va envoyer en détention préventive, le rapport de force et de pouvoir qui s’installe entre un prévenu et son juge. Tout ce qui caractérise la justice de classe du système judiciaire tel qu’il est organisé concrètement par la pénurie de moyens matériels et humains est passé sous silence par des images qui assomment le spectateur « du poids des mots et du choc des photos »
Pour conclure, merci à toi de nous avoir rappelé les mots du premier directeur de la BBC: » Celui qui se flatte de donner au public ce que souhaite ce dernier, ne fait, le plus souvent, que créer une demande pour la médiocrité afin de la mieux satisfaire ensuite. ». Je persiste à penser que les citoyens, dans leur majorité, ne demandent pas ce qu’on leur fait demander.
Et si on créait quelque chose qui s’apparente à Arte, mais qui soit centré sur l’information belge?
Bien amicalement à toi, Pierre
Merci Pierre, nous sommes évidemment d’accord, y compris sur la juge de Strip Tease.